Calisph'Air / GAO
La mission GAO : Generali Arctic Observer
L'expédition
Après avoir atteint le pôle en traîneau après 63 jours en 1986, dérivé quatre mois sur la banquise à bord du Polar Observer en 2002, Jean-Louis Etienne a fait construire une rozière, un ballon mixte hélium/air chaud, dont la nacelle a tout spécialement conçue pour son nouveau rendez-vous avec l' Arctique.
Au fur et à mesure de ses expéditions, Jean-Louis Etienne a pu constater les changements au niveau de la banquise (amincissement, rétrécissement) et par cette aventure il souhaite attirer l’attention du public sur cet écosystème fragile qui régressé de presque 15% en 30 ans.
L’expédition Generali Arctic Observer va également contribuer à faire avancer la connaissance scientifique. Des capteurs embarqués à bord de son ballon mesureront le taux de CO2 atmosphérique, l’ozone, le champ magnétique et les particules en suspension (ou aérosols) dans l’air.
Les données, envoyées en temps réel aux chercheurs, permettront d’affiner les modèles d’évolution du climat.
Le parcours
Jean-Louis Etienne et son ballon s'élanceront de l'archipel du Spitzberg, camp de base de l'expédition aux alentours du 6 avril 2010, en fonction des conditions météo.
Son parcours le mènera au bout de 1300 kilomètres en ligne droite au pôle Nord puis, 2200 kilomètres après, aux côtes de l'Alaska en tirant le meilleur parti des veines de vent et des niveaux d'altitude du ballon.
La position GPS du ballon de Jean-Louis Etienne, l'altitude, direction et vitesse seront transmises automatiquement toutes les 15' au PC vol, situé chez le principal sponsor de l'expédition, GENERALI à St Denis.
> Voir aussi :
- La vidéo de présentation de l'expédition sur la vidéothèque du CNES
- L'expédition GAO sur le site de Jean-Louis Etienne
- L'explédition GAO sur le site de Generali
- La page "Generali Arctic Observer" sur Facebook
Les mesures scientifiques
Le champ magnétique terrestre
Le champ magnétique terrestre est en constante évolution. Ses variations sont encore mal comprises. Afin de mieux les expliquer, les scientifiques mènent des études à partir de mesures au sol, grâce à des observatoires magnétiques, ou depuis l’espace.
Le magnétomètre absolu de Swarm
La mission GAO de Jean-Louis Etienne est une occasion d’effectuer des relevés du champ magnétique terrestre au dessus de la zone polaire arctique, région rarement observée.
Le CNES et le CEA/LETI fourniront à cet effet un magnétomètre absolu qui mesurera l’intensité du champ magnétique terrestre tout au long du parcours.
Cet instrument est identique à ceux qui seront embarqués à l’horizon 2012 sur les trois satellites Swarm de l’ESA.
Les données seront exploitées par notre partenaire scientifique, l’Institut de Physique du Globe.
L’objectif de cette mission spatiale est de procéder à l’étude la plus complète jamais entreprise du champ géomagnétique terrestre et de son évolution dans le temps. Elle permettra d’améliorer notre connaissance du système terrestre en apportant un nouvel éclairage sur les processus qui se déroulent à l’intérieur du globe et sur les interactions entre le champ géomagnétique et le climat.
> Voir aussi : Le supplément "CNES Educ" consacré au champ magnétique
Les particules en suspension
L'atmosphère se compose de molécules de gaz et de petites particules solides et liquides en suspension dans l'air, appelées aérosols.
Certains aérosols sont naturellement produits par les volcans, les embruns (océans), le sable ou l'érosion de surface provoquée par le vent. D'autres aérosols résultent de l'activité humaine, comme la poussière issue des activiés agricoles, la fumée résultant de la combustion de la biomasse des énergies fossiles, le brouillard induit de manière photochimique par les pollutions de véhicules. Les gouttes et cristaux de glace résultant de la condensation de l'ea sont aussi des aérosols.
Aérosols au pôle
Les particules en suspension dans l'atmosphère déterminent le climat tout autant que les gaz à effet de serre.
En effet, les particules en suspension modifient le bilan énergétique de la Terre en dispersnat et en bsorbant la lumière du soleil, en altérant la luminosité et en influant sur la nébulosité et les précipitations.

Des satellites comme Calipso (mission CNES/NASA) ont été déployés pour mieux comprendre ces effets.
De plus, ces particules qui proviennent en partie des pots d’échappement, de la fumée des usines contiennent des polluants (pesticides, métaux lourds, …) toxiques pour l’environnement et la santé.
Jean-Louis Etienne va mesurer la quantité de particules acheminées par les courants atmosphériques au dessus de l’Arctique et effectuer des prélèvements pour en déterminer l’origine.
Ces données seront utilisées pour les classes du projet éducatif d’étude de l’atmosphère Calisph’Air, qui permet de croiser des mesures réalisées localement avec des données satellites.
> Voir aussi :
- Le dossier "Parasol, ou comment sortir les climatologues du brouillard"
- "Pollution atmosphérique : 30 ans de visibilité", sur le site de la Cité des Sciences
Mesurer l'ozone
Jean-Louis Etienne mesurera l’ozone troposphérique avec un ozonomètre portable, développé par le programme éducatif international GLOBE.
L’ozone (O3 ou trioxygène) bien que présent en très petite quantité dans l’atmosphère, en est un composant clé.
ll ne faut pas confondre :
- l’ozone stratosphérique (entre 16 et 50 km), qui nous protège des rayonnements UV du Soleil, nocifs pour les êtres vivants et qui est détruit par le chlore (CFC…) principalement au dessus des pôles (trou d’ozone) ;
- et l’ozone troposphérique (entre 0-16 km) à l’origine des épisodes de pollution durant les périodes anticycloniques de fort ensoleillement.
Les résultats de ces mesures seront fournis aux classes du projet éducatif Calisph’Air qui feront des mesures et les croiseront avec les données satellites (instrument IASI sur le satellite Metop) pour mieux comprendre comment ce polluant se propage.
> Voir aussi :
- "IASI mesure la pollution à l'ozone", sur le site du CNES
- "Theseo, 3ème campagne européenne de mesure de l'ozone stratosphérique", sur le site du CNRS
Le dioxyde de carbone (CO2)
Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz à effet de serre dont l’augmentation de la concentration atmosphérique depuis la révolution industrielle semble jouer le plus grand rôle dans le réchauffement climatique actuel.
Actuellement la connaissance des flux de CO2 est déduite soit des iventaires, soit de mesures locales sur les écosystèmes (tours à flux), soit des concentrations atmosphériques observées par les réseaux de stations au sol.
Or, la structure de la banquise ne permet pas d’établir de base permanente au dessus du pôle Nord. L’expédition de Jean-Louis Etienne permettra de recueillir des données fiables sur les quantités de CO2 d’origine exogène sur l’Arctique.
En effet, au printemps, la végétation environnant les latitudes polaires n’a pas encore repris, on considère que le dioxyde de carbone issu de la photosynthèse sur place est quasiment inexistant.
Ainsi, à l’aide des modèles de circulation de masses d’air et de l’ensemble des données transmises par la sonde embarquée, il sera possible de mieux comprendre la circulation du CO2 autour du pôle Nord.
L’expérience va permettre de tester aussi dans des conditions extrêmes une sonde de mesure miniaturisée, ce qui est très important pour l’établissement de stations futures. La sonde embarquée a été conçue par la société Vaisala, calibrée et conditionnée par le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement ( CEA/CNRS). La mesure des teneurs atmosphériques dans les conditions de cette expédition représente un véritable défi.
CarboSchools, projet européen qui associe des chercheurs et des professeurs autour de la question du cycle du carbone pour mener des activités en classe de collège et de lycée, est aussi partenaire de cette expédition. En effet, l’expédition peut être une excellente application de ce qu’auront étudié les élèves pendant l’année qui suivront les mesures du CO2 atmosphérique effectuées par Jean-Louis Etienne.
Des satellites pour mesurer le CO2
L’émission moyenne de CO2 par an et par habitant est estimée à 8,26 tonnes en Europe de l’Ouest, 20 tonnes en Amérique du Nord et 0,82 tonne en Asie
du Sud.
Une mesure spatiale du CO2 atmosphérique doit permettre de connaître le bilan carbone de régions pratiquement dépourvues de stations de mesure, comme l’Amazonie, l’Afrique et les régions boréales. En janvier 2009, le Japon a lancé Gosat/Ibuki, la première mission spatiale destinée au suivi du cycle du carbone. Côté américain, la Nasa étudie la possibilité de redévelopper la mission Oco qui a subi un échec au lancement début 2009.
Le projet Microcarb du CNES
Fort de son expertise en matière de sondage par spectrométrie haute résolution développée pour le projet Iasi dans les années 1990, le CNES a lancé dès 2001 des études préliminaires sur un concept de spectroscopie passive innovant, l’interférométrie statique (objet d’un brevet du CNES). Le projet Microcarb vise à offrir une capacité d’observation du CO2 grâce à un instrument robuste, relativement compact et peu onéreux.
Un des scénarios inclut son emport sur un microsatellite en orbite à 700 km pour assurer les observations sur terre et sur océan. L’instrument devra mesurer le rayonnement solaire réfléchi par la Terre dans le domaine de longueurs d’onde du proche infra-rouge. La molécule CO2absorbe une partie du rayonnement et elle absorbe d’autant plus qu’elle est abondante. En analysant le spectre obtenu par l’instrument, on pourra ainsi mesurer la concentration en CO2 sur une colonne atmosphérique.
Des missions spatiales de ce type pourront apporter une vision homogène à l'échelle planétaire en complément de mesures plus précises effectuées au sol.
- Pourquoi le CNES propose-t-il de développer la mission Microcarb, destinée à étudier le carbone ? En audio, (un extrait de programme de podcasts du CNES) la réponse de Carole Deniel, responsable des programmes Composition atmosphérique au CNES
Ecouter l'épisode :
> Voir aussi :
- "De l'espace, une meilleure vue sur le réchauffement", sur le site Terraeco.net
Evolution de la banquise
Les glaciers et la banquise sont surveillés par les satellites car ils jouent un rôle déterminant dans le processus climatique En effet, l'étude de la fonte des glaces polaires, avérée dans l'hémisphère nord, est un enjeu majeur pour comprendre le réchauffement climatique.
Sites internet utiles
- Le site du National Snow and Ice Data Center (NSIDC) vous permet de télécharger des fichiers "Google Earth" concernant la banquise et d'établir des comparaisons sur plusieurs années.
- Les ressources sur la banquise sur le site de Jean-Louis Etienne
- Mercator modélise la banquise
Une approche simple des glaces de mer et du rôle des satellites sur le site de Mercator.
- Rupture de la glace dans l'Océan Arctique
Article poposé par l'ESA (Agence spatiale européenne), sur son site Education.
- Cryosphère satellitaire
Des informations vulgarisées pour le grand public et l’éducation sur le site du Laboratoire d’Etudes Géophysiques et Océanographie Spatiale (LEGOS).
- Le satellite ENVISAT classifie la neige des calottes polaires
Article sur le site de l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS.
A la veille du lancement de Cryosat, satellite qui suivra pendant 3 ans l'évolution des glaces, l'équipe du Journal de l'Espace a interrogé les passants sur la banquise, les glaces et autres inlandsis... :
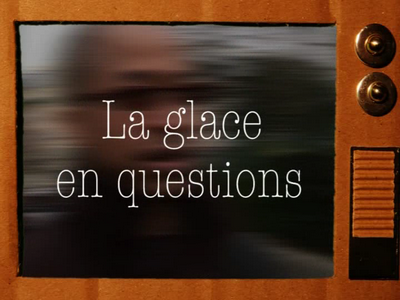
> Voir aussi :
- La fonte des glaces responsable de la hausse du niveau marin depuis 2003 : Un débat autour d’un article scientifique sur une nouvelle synthèse de données satellitaires et océaniques sur le blog d’un journaliste scientifique de Libération.
- Apport crucial des données satellites aux conclusions de l’ONU sur le climat : Sur le site de l'ESA, un rapport sur le changement climatique (…) a été publié à Paris le 1er février 2007 soulignant la hausse globale des températures et du niveau de la mer.
- Zoom sur "les glaces de mer" : Un dossier très complet proposé par l'IFREMER.
- Sur le site de l'Académie de Nice : des pistes d'activités sur l'évolution de l'Arctique (Terminales scientifiques)
Calisph'air / GAO : volet éducatif et projets de classes
Projet éducatif
Comme dans ses expéditions précédentes, Mission Banquise en 2002, Mission Clipperton en 2005, le nouveau défi de Jean-Louis Etienne est encore l'occasion d’offrir à la communauté éducative les éléments favorisant la mise en œuvre de projets pédagogiques liés à l’Education au Développement Durable.
Le CNES s'associe à ce volet éducatif via son projet Calisph'Air d'étude de l'atmosphère. Une campagne de mesures Calisph'Air est prévue à partir du 22 mars 2010, à laquelle participent une trentaine de classes en France, Allemagne, Guyane et Etats-Unis.
Nous vous proposons une animation qui fait le point sur les enjeux de GAO et sur les satellites qui contribuent à une meilleure connaissance des dérèglements climatiques :
Comme lors de nombre des expéditions de Jean-Louis Etienne, Generali Arctic Observer offre une multitude de pistes pédagogiques à utiliser pour un travail en classe. Vous les trouverez sur le site Education de l'expédition.![]() Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 1 (pdf - 549.22 Ko)
Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 1 (pdf - 549.22 Ko)![]() Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 2 (pdf - 709.42 Ko)
Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 2 (pdf - 709.42 Ko)![]() Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 3 (pdf - 736.38 Ko)
Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 3 (pdf - 736.38 Ko)![]() Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 4 (pdf - 748.48 Ko)
Télécharger la lettre GAO Educ Info n° 4 (pdf - 748.48 Ko)![]() Téléchargez la lettre GAO Educ Info n° 5 (pdf - 559.66 Ko
Téléchargez la lettre GAO Educ Info n° 5 (pdf - 559.66 Ko
Au coeur de la Guyane
À Camopi, petit village amérindien au sud-est de la Guyane, les projets scientifiques menés régulièrement avec le CNES prennent une dimension particulière. Calisph’Air projet d’étude de l’atmosphère et du climat y mêle approche scientifique et ouverture sur l’extérieur.
La science, fenêtre sur le monde
La centaine d’élèves accueillie au collège est exclusivement composée d’enfants amérindiens. Ils vivent sur une zone protégée. L’accès y est très réglementé, le tourisme interdit. De toute façon, il faut 5 à 12h de pirogue —selon le niveau des eaux— pour rallier Camopi depuis Saint George, la ville la plus proche.
Issus de deux tribus, les Wayãpi et les Teko, les enfants sont imprégnés d’une culture ancestrale ou le rapport à la nature domine leur vision du monde. Pour eux, c’est une évidence : l’homme et la nature sont étroitement liés.
Dans ce contexte, les observations et mesures scientifiques du projet Calisph’Airbasé sur l’expérimentation, leur permet une autre approche de la réalité et… du monde extérieur.
« Contrairement à leur culture où l’on ne réalise une tâche que si l’on est sûr de la réussir, par exemple, l’expérimentation scientifique introduit le tâtonnement et les bienfaits de l’erreur qui permet de valider ou invalider des hypothèses. La science offre ainsi une ouverture sur d’autres modes de fonctionnement.»
explique Daniel Baur, l’enseignant qui pilote le projet Calisph’Air à Camopi.

Dans le cadre de Calisph’Air, les élèves étudient les particules en suspensions dans l’air, l’observation de la couche nuageuse ou encore la pluviométrie. Comparer ces données avec celles recueillies en d’autres points du globe permet de prendre conscience des variations et d’en chercher les causes.
Et à travers ce projet, Camopi correspond avec des établissements français… quand la liaison Internet le permet. En 2009, un workshop en Guyane a également amené les élèves à rencontrer des classes américaines, mexicaines, et des visioconférences permettent d’autres échanges.
Un ballon stratosphérique
Daniel Baur est ses élèves sont allés plus loin. En 2009, ils ont lancé, avec les animateurs du Cnes, un ballon stratosphérique lors de l'opération "L'espace au fil du fleuve" (une initiative du CNES et du Rectorat de Guyane).
Comme Jean-Louis Etienne en avril 2010, ils ont embarqué à son bord des expériences de mesures liées à Calisph’Air. « Le projet Calisph’Air est pour moi le tronc central de notre travail scientifique, détaille Daniel Baur.
De là, nous déployons des branches et travaillons par exemple les mathématiques (construction de la nacelle, mesures,…) ou la géographie (échanges avec d’autres établissements dans le monde).»
Autant dire que, pour eux, l’expédition de Jean-Louis Etienne recèle de multiples intérêts...
Outre les mesures réalisées à partir d’un ballon semblable au leur, et dans un milieu si différent, elle donne véritablement le sens du lien entre les différents phénomènes climatiques de la planète. De tels projets introduisent également auprès de ces enfants la notion de temps et d’avenir. Notions qui leur sont, là encore, étrangères mais que les différentes étapes d’un projet scientifique (conception-planification-financement) font concrètement toucher du doigt.









